Séraphin LAGIER arrive à
Foncine le bas le 1er mai 1867 et présente au conseil de fabrique
la commission que lui a signée Mgr NOGRET, évêque
de Saint Claude. Originaire de Viry, il a été vicaire
à Fort du Plasne puis à Foncine le haut avant d'être
nommé curé de Peintre (canton de Montbarrey). Il a donc
déjà de l'expérience.
Il remplace Louis Joseph MICHAUD mort
le 1er avril 1867 à la cure où il a passé 51
ans.
Le 7 juillet, le conseil de fabrique
se réunit pour faire l'inventaire des biens de la paroisse
:
Il y a en caisse 6032 francs, mais
tout est mélangé : le capital (632 francs) et les intérêts
(400 francs) provenant de dons pour les missions et les retraites;
le leg de Mr CORDIER (1500 francs), destiné à la réfection
de la sacristie; et la réserve (3500 francs) que la fabrique
a prévu pour la restauration de l'église.
La cure est en piteux état.
Le nouveau curé ne peut se contenter du logement qu'occupait
son prédécesseur. Les deux derniers évêques
de Saint Claude (Mgr MABILE et FILLION) l'ont d'ailleurs reconnu lors
de leurs visites pastorales. En outre l'évêque et les
missionnaires doivent pouvoir y être logés lorsqu'ils
viennent dans la paroisse. Ce n'est évidemment pas le cas.
La sacristie est "tout à
fait petite et si humide qu'on ne peut y laisser ni les ornements
ni les fleurs";
L'église est "dans un
pauvre état tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Le couvert de la grande nef est complètement usé; le
clocher menace ruine";
Le cimetière est trop exiguë.
Séraphin LAGIER va s'occuper
de tout cela.
 La
Cure La
Cure
Elle est réparée sans
intervention de l'architecte, sous la direction d'Aimé PERRENET,
huissier, trésorier de la fabrique, et bien entendu du curé.
Coût 4500 francs, fournis par la fabrique et 2000 francs par
la commune. Tout le monde est content.
Il faut aussi délimiter le
jardin. Il s'agit "d'une pièce de terre en nature de clos,
d'environ 18 ares, implantée d'arbres, dite le clos de la cure,
jouxtant de bise le Galaveau".
Ce jardin dont Séraphin LAGIER
donne un croquis, a appartenu à la paroisse, avant d'être
saisi comme "bien national" sous la révolution. Acheté
par Alexandre CHANEZ, il a appartenu ensuite aux frères Pierre
Antoine, Claude Joseph, Jean Baptiste et Alexis férréol
FUMEY du MOULIN. Puis à Richard et Pierre Angélique
MARTIN et à Claude et Jean-Pierre FUMEY du MOULIN.
Apparemment les limites n'ont jamais
été marquées. En 1867, François MARTIN,
héritier d'une partie, conteste la barrière posée
par le curé. Il faudra un long procès pour le ramener
à la raison.
 La Sacristie La Sacristie
Elle est réparée en
1868 : Prosper DAYT, maçon, fait le gros oeuvre; Nestor BOURGEOIS
la charpente et la menuiserie, François JACQUET les meubles
et les seize tiroirs destinés aux ornements. Coût total,
environ 1000 francs. 500 francs sont prélevés sur le
legs fait au curé de la paroisse par le notaire Cordier.
 Le
Cimetière Le
Cimetière
Sévère PAGNIER, un Pagnier
du Bourg venu de la Norbière après un passage par la
Chevrie, marchand de bois d'usage et fabricant de pignons d'horloges,
dont la maison est séparée de la cure par le Galaveau,
vend le 25 août 1871 à Alfred PROST, Claude BOURGEOIS,
Aimé PERRENET, Joseph MUNIER, maire, et Séraphin LAGIER,
curé, tous membres du conseil de fabrique, une pièce
de terre qu'il possède derrière l'église, "N°
826 de la matrice cadastrale, d'une contenance de 2 ares et 48 centiares,
joignant au levant et au midi, le vendeur, au nord Auguste CORDIER,
Aubin POUX, Jean BOURGEOIS et les héritiers de Pierre Denis
HUGONNET et au couchant Claude François MARTIN". Prix
100 francs.
Il semble que cette cession ait été
soumise à des conditions particulières. Elle échappe
en effet à la réglementation concernant les attributions
des places. Une partie de ce nouveau cimetière a été
longtemps réservée à la famille Pagnier, qui
a quitté Foncine le bas depuis près de cent ans. Une
croix en bronze porte encore ce nom.
 Tombe
du curé Michaud Tombe
du curé Michaud
Séraphin LAGIER n'oublie pas
son prédécesseur. Il estime qu'il est de son devoir
d'élever un modeste monument en son souvenir. Mademoiselle
MICHAUD, nièce et servante de Monsieur MICHAUD lui a d'ailleurs
donné 225 francs dans ce but. Il fait appel à un fondeur
de Besançon. Coût : "pour l'entourage gothique 110
francs, pour la croix avec son pied 115 francs. Il y a fait porter
l'inscription suivante :
"A la mémoire de Louis
Joseph MICHAUD, prêtre né à Foncine le haut le
1er janvier 1790 et décédé le 19 avril 1867,
curé de Foncine le bas, son unique paroisse depuis 50 ans
Lex elementiae in ligna ejus"
C'est Prosper DAYT qui a placé
la tombe.
Séraphin LAGIER ajoute les précisions suivantes : "Monsieur
MICHAUD repose au lieu même où il a désiré
être enterré pendant sa vie, à l'endroit où
reposaient les restes vénérés d'un de ses prédécesseurs,
Mathieu GUYON".
Il ajoute même "quand les
lettres de cette inscription ne seront plus dorées, il sera
facile d'enlever la plaque retenue et fixées par des clous
à vis et de la faire redorer".
Louis Joseph MICHAUD était
né à La Chevrie, sa nièce sera enterrée
plus tard à ses côtés.
 L'Église L'Église
C'est évidemment le gros morceau.
La voûte en tuf est à quatre mètres au-dessous
de celle du choeur. La grande nef n'est éclairée que
par deux petites fenêtres qui ne sont même pas placées
vis à vis l'une de l'autre, à l'extérieur c'est
encore plus triste. Le couvert de la grande nef est complètement
usé... de plus le clocher construit en bois et très
peu élevé menace ruine.
Mais il n'y a pas de ressources de
la part ni de la commune, ni de la fabrique. Aimé PERRENET
le trésorier, frappe à toutes les portes. Finalement
la commune vend des terrains communaux pour 10000 francs et le gouvernement,
adroitement sollicité, accorde une subvention de 2500 francs.
On choisit comme architecte M. ROY de Baume les Messieurs. Les travaux
sont adjugés le 2 mai 1872 à Jules BOULAND de Saint
Laurent pour 10000 francs. La subvention étant jugée
suffisante pour les imprévus.
Aussitôt BOULAND, sans qu'il
y ait nécessité immédiate, met à découvert
une grande partie des chapelles latérales ainsi que la voûte
de la grand nef. Celle-ci s'écroule sur la chaire, sur les
bancs, sur les autels des chapelles. Les dégâts sont
estimés à 1200 francs. De plus, par suite de l'humidité
la voûte de la chapelle gauche menace ruine. L'ancien clocher
tombe; la cloche reste suspendue sur le cimetière pendant quatre
ans, en attendant qu'on puisse la remonter. ROY et BOULAND, l'architecte
et l'entrepreneur, ne sont plus d'accord. Cela va durer dix ans.
Séraphin LAGIER écrit
"L'ancienne voûte devait subsister, mais il n'y avait presque
plus de couvert au dessus, et elle a fini par tomber sur les bancs.
Alors nous en avons été quittes pour débarrasser
les matériaux, et nous étions toujours exposés
aux inconvénients de tous les airs. Une année je n'ai
pu célébrer la messe de minuit et il y avait à
l'église un bon mètre de neige sur les bancs".
C'est finalement Auguste BOURGEOIS,
de la gypserie, alors curé de Bréry qui a payé
pour faire une nouvelle voûte en bois. Il lui en a coûté
mille francs.
"Après quoi, continue
S. LAGIER, l'architecte a eu bien des maux pour se débarrasser
de BOULAND, l'entrepreneur. Ensuite j'ai été libre de
faire faire un beffroi neuf pour remplacer la cloche qui était
sur le cimetière. Puis j'ai fait placer 4 fenêtres dans
la grande nef avec des vitraux l'année suivante".
En 1894 l'abbé LAGIER fait
procéder à un rajeunissement des boiseries et peintures
de son église. L'entreprise Jacques RICARDONE Neveu de Morez
refait les peintures et décorations du choeur de la grande
nef, des autels, des stalles et des bancs. Il installe une ventilation,
lave et retouche les vitraux, les ferrures ... etc. Il en coûtera
1700 francs. En outre Ernest CLEMENT s'occupera de la façade
de l'église côté bize, les frères CRETIN
consolideront la chaire à prêcher, Paul JEUNET placera
une porte neuve à la chapelle de la Sainte-Vierge.
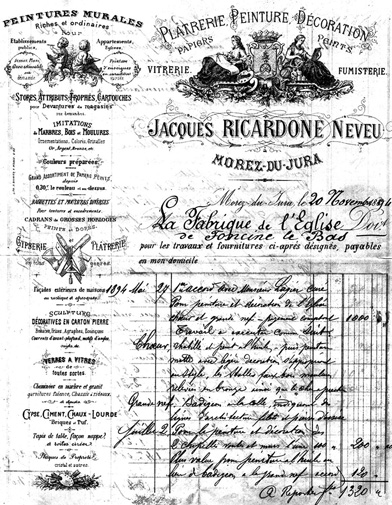
 Les
Statues Les
Statues
Tous les dix ans environ, on organise
une mission, prêchée par un ou plusieurs prêtres
étrangers à la paroisse. Et à chaque fois on
érige une statue. Séraphin LAGIER ne déroge pas
à cette habitude.
Avant lui, Louis Joseph MICHAUD avait
fait installer dans le rocher qui se trouve en haut des gorges de
Malvaux, une statue de la vierge connue sous le nom de "Notre
Dame de Malvaux". Elle avait été inaugurée
le 27 mai 1855. Les frais avaient été payés par
la famille de Pierre Angélique MARTIN.
Les MARTIN sont marchands de bois
en gros et possèdent une scierie et un moulin. En 1806, si
l'on se réfère à un rôle de répartition
concernant "Ceux du côté de vent du Galaveau",
dont l'objet est la répartition des dépenses destinées
à la construction du presbytère, ils figurent parmi
les plus riches de la paroisse, avec Claude François FUMEY
du MOULIN, Claude Antoine RUTY, Bonaventure DAYT et Jean Joseph PERRENET.
Ils possèdent, sur le chemin
qui conduit de la Gypserie à Combe David, une maison qui existe
toujours. Deux fils de Pierre Angélique sont devenus prêtres
: Jean Joseph, né le 26 novembre 1791, curé de Saint
Laurent la Roche puis de Crans où il est mort en janvier 1868,
et Pierre Marie né le 11 décembre 1793, supérieur
du séminaire de Nozeroy puis vicaire général,
décédé le 31 mars 1860. Les deux ont été
inhumés à Foncine le Bas.
Ci-dessous copie du diplome de diaconat
de Pierre Marie daté de 1818. On remarquera qu'alors, cette
partie du Jura relevait du diocèse de Besançon, celui
de Saint Claude n'ayant été créé qu'en
1822, et que le latin était alors la langue officiel de l'église.
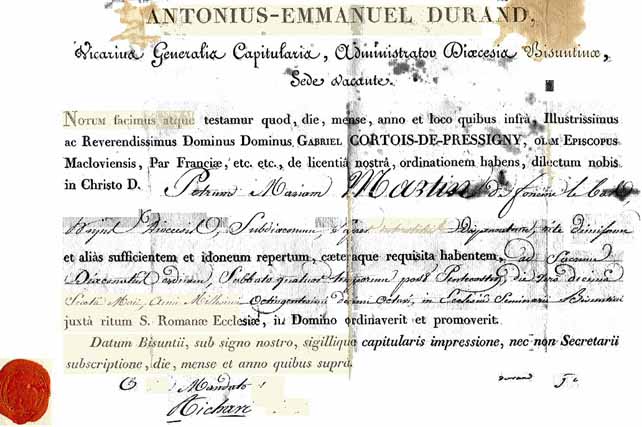
Dès son arrivée, en
1816, Louis Joseph MICHAUD avait commandé un chemin de croix
pour son église. Ce chemin de croix a été inauguré
le 23 septembre 1821.
En face de cette statue, de l'autre
côté de la route, un belvédère surplombe
la Saine de plus de 70 mètres. C'est de ce point que le 14
juillet est tombé Lucien Fougeres, jeune parisien, qui depuis
plusieurs années venait comme berger chez les Cordier de la
Sange Renaud. On ne retrouva son corps qu'après la décrue
de la Saine dix jours plus tard.
La statue, déplacée
en raison de l'aménagement de la route sera réinstallée
et le belvédère sécurisé prochainement.
Après celle de mars 1869, c'est
Pierre Marie BOURGEOIS qui remet deux cents francs pour en installer
une le plus près possible de sa maison (La Gypserie).
Ce sera
la "croix de mission" que l'on voyait encore il y a une
dizaine d'années dans le tournant qui se trouve entre la Gypserie
et vers chez André. LAGIER regrettait de ne pas avoir pu l'installer
plus près du village.
Dans le compte-rendu qu'il enverra
à "la semaine religieuse", l'abbé Zoïle
THORAX, curé doyen de Foncine le haut, qui avait présidé
la cérémonie d'inauguration, écrit :
"l'érection
de cette croix eut lieu le jour de Pâques. Ce fut, du matin
au soir comme un des plus mauvais jours d'hiver : ciel gris et noir,
neige sèche et froide tombant constamment, chemins obstrués.
La distance à parcourir depuis l'église au lieu préparé
pour recevoir la croix était à deux kilomètres
au moins. Grands obstacles à vaincre. On fait passer la charrue
sur la route et à 5 heures du soir la croix sort de l'église
portée triomphalement par quatre robustes jeunes gens ... La
nuit arrivait quand la procession rentra à l'église".
Les
BOURGEOIS de la Gypserie sont aussi ceux qui lèguent à
la fabrique deux champs entre Rapoutier dessus et Rapoutier dessous
en 1871. Auguste BOURGEOIS curé de Bréry, déjà
cité, est de ceux-là. Une plaque en marbre dans la chapelle
gauche honore ce "bienfaiteur".
En
1875 ce n'est qu'une croix en bois qu'il a pu installer "au hameau
du Mont noir, près de la route qui conduit à Chapelle
des Bois", près des maisons des Martins et des Petetin.
Le
21 mai 1877, on installe en grande pompe la statue de Notre Dame de
Lourdes sur une colline dominant la paroisse.
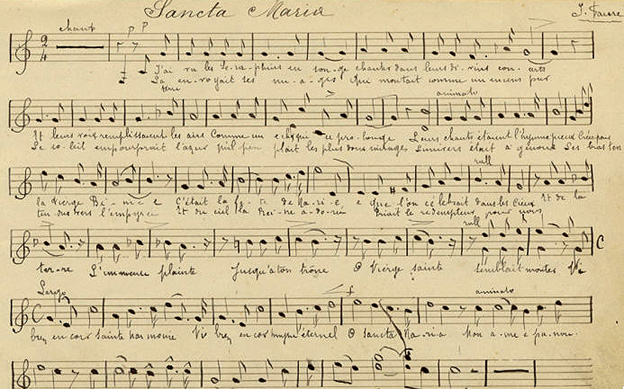
Il y a là plus de 2000 personnes
qui processionnent sous un ciel pur et serein. On ne dit ni qui a
prit l'initiative, ni qui l'a construite. Une souscription avait été
organisée en 1876. Elle avait rapporté 453 francs 95;
La femme de Léon VUILLERMOZ, Jules BARBAUD, Alfred PROST, l'agent
voyer PERRENET, M. CORDIER, Achille POUX, Aimé JEUNET de "sur
la place", Paul JEUNET bijoutier, dame PELLERIER, la domestique
de Madame PROST, avaient donné chacun 10 francs; Mesdemoiselles
BRAZIER de l'auberge 12 francs; Victorine de chez la veuve CLEMENT
comme François MARTIN 20 francs. Toute la population semble
avoir participé.
En 1885, il y a eu des illuminations
mais semble-t-il pas de statue. Pourtant les exercices avaient été
bien suivis "à l'exception d'une quinzaine qui sont
restés insensibles à la grâce du Seigneur".
En 1897 des cérémonies
sont organisées dans toute la France et plus particulièrement
en Saône et Loire et dans le Jura, en l'honneur du Sacré-Coeur.
Foncine le haut érige une statue qui sera bénite en
avril 1899. Séraphin LAGIER veut faire de même dans sa
paroisse. Il meurt avant la réalisation de son projet. Ce n'est
qu'en 1900 à l'issue de la mission traditionnelle que sera
inaugurée la statue que l'on voit sur le côteau à
proximité de l'école. Cette statue a été
érigée sur un terrain d'environ 40 m2 encadré
de quatre sapins. les sapins ont grandi; l'un a été
cassé par la tempête; le sentier qui conduisait à
cette statue a été mangé par la route élargie.
Et ce site est maintenant, en principe, inaccessible même à
pied.


Les générosités du
curé Lagier
Séraphin LAGIER va aussi s'occuper
de l'intérieur de l'église.
Le 24 avril 1870 il informe le conseil
de fabrique qu'il a utilisé les 200 francs donnés par
le docteur MUNIER et les 1000 francs donnés par le notaire
CORDIER à cet effet. Dans un premier temps il a acheté
:
Une chasuble en drap d'or, deux dalmatiques
de même texture, une chasuble rouge et une chasuble verte en
Damas soie, deux dalmatiques noires pour les offices des morts, deux
surplis et une aube pour la sacristie.
En outre il a payé la réparation
des portes d'entrées, de la chaire à prêcher et
de son escalier, des vieux ornements et des bancs du choeur.
"Il ne doit rien à la
fabrique et il n'était pas obligé de rendre compte;
mais il veut bien le faire et entrer dans le détail afin que
tout le monde sache à quoi cet argent a été employé".
En juillet 1870, il ajoute à
ces cadeaux :
Deux lustres en cristal, une chape
en drap d'or pour les fêtes solennelles, un grand tapis en feutre
pour les grandes solennités.
Et là il précise : "Si
dans tous les cas, les habitants de la paroisse, (comme on ne le pense
pas), venaient à se soulever contre lui et à le contrarier
de telle sorte qu'il soit obligé de demander à Monseigneur
son changement, il pourrait reprendre à l'église tout
ce qu'il a donné ou le laisser en en faisant payer à
la fabrique toute la valeur constatée d'après les factures
qu'il a entre les mains".

C'est
aussi Séraphin LAGIER qui s'occupe des cloches. En 1883 est
lancée une "souscription publique pour l'achat d'une grosse
cloche comme souvenir de la mission de 1883". Il récolte
4082 francs. Lui-même qui est parrain, Marie PROST, qui est
marraine ainsi qu'Auguste BOURGEOIS (encore lui) et Philippe BOURGEOIS,
donnent chacun 500 francs; François MARTIN, sans doute celui
qui contestait les limites du jardin du curé, 100 francs. Là
aussi on a la liste des habitants de Foncine le bas en 1883.

Vers 1830 la petite cloche, la seule
qui existait alors "a été brisée à
l'arrivée de Mgr de CHAMONT qui venait administrer le sacrement
de confirmation". Une souscription pour sa refonte a rapporté
984,55 francs. Il s'agit sans doute de celle qui a du être descendue
en 1999 lors de la réfection du clocher et dont la marraine
était Anna PAGNIER.
La paroisse a remercié l'abbé
Séraphin LAGIER en posant dans la chapelle gauche une plaque
en marbre qui rappelle qu'il aimait ce qui était beau.
Il faut se souvenir que Séraphin
LAGIER, avant de venir à Foncine le bas, avait été
vicaire à Foncine le haut. Or comme le rappelle Andrée
LECOULTRE dans son "Foncine le haut, en remontant la Saine",
c'est l'abbé THORAX qui a réparé et embelli l'église
et le presbytère.
C'est au temps de Séraphin
LAGIER semble-t-il, qu'ont été posés :
le tableau de l'immaculée conception
en face du Sacré Coeur, donné par les abbés MARTIN,
les tableaux de la visitation et de Saint Denis donnés par
M. CORDIER avocat, le reliquaire émaillé de rubis par
Thérèse MUNIER épouse BLONDEAU et sa fille Sophie.
 Les
religieuses Les
religieuses
L'abbé Jean Férréol
MICHOUDET, curé de Nogna, inhumé le 20 février
1871 à Foncine le bas où il est né en 1798, a
légué à sa paroisse d'origine une somme assez
importante en vue de la création d'une école enfantine.
Cette somme a été prêtée au grand séminaire
de Montciel à 4% l'an en attendant des religieuses enseignantes.
En 1885 il n'y a toujours pas d'école et il y a en caisse,
capital et intérêts, un peu plus de 14000 francs. Le
trésorier gère tout cela "en bon père de
famille"; il achète des obligations du P.L.M, du Crédit
Foncier et de l'emprunt Russe. Et il verse chaque année, selon
une clause de testament, 200 francs à Marie Lucie BASSAND,
nièce du donateur.
C'est entre 1886 et 1892 que les religieuses
arrivent. Elles viennent du couvent Saint Joseph de Champagnole, couvent
qui fournit les infirmières de l'hôpital de cette ville.
On connaît quatre noms : Soeur Augustine, Soeur Herminie, Soeur
Mathilde et enfin Soeur Colette, la plus jeune. Leur formation hospitalière
fait que rapidement elles ajouteront à leur fonction d'enseignante,
celle de garde-malades et d'infirmières. Ce que n'avait évidemment
pas prévu l'abbé MICHOUDET. Cette situation va créer
des difficultés.
Financières d'abord. Ce que
verse le trésorier est insuffisant et les locaux trop petits
et inconfortables. Et puis déjà les salaires sont trop
bas. Sœur Colette réclame de l'argent et des locaux. Mère
Marie Ange, la supérieure de Champagnole reste sourde. De même
le trésorier du grand séminaire. Il a déjà
dû entamer le capital et envoie des mises en garde au curé.
Et puis il y a des querelles intestines
: Sœur Colette préfère visiter les malades plutôt
qu'instruire les enfants. Elle dit n'avoir pas le temps d'accomplir
ces deux tâches. Mère Marie Ange a beau lui répondre,
directement ou par l'intermédiaire du curé, qu'elle
peut très bien visiter ses malades après onze heures
et après quatre heures. Elle lui rappelle d'ailleurs que compte
tenu de son état de santé, elle devrait éviter
de sortir ... En vain ...Elle demande à loger à la cure
où elle pourrait se reposer mieux. Le curé est favorable.
La réponse est là aussi défavorable.
En 1918, l'abbé H. GAILLARD
intervient pour obtenir une religieuse qui seconde l'équipe
ou remplace sœur Herminie. Celle-ci ne peut plus ou ne veut plus
s'occuper des enfants. Vu son âge et sa santé, elle ne
supporte plus les enfants. Les gamins le lui rendent bien ... Sœur
Marie Ange n'a personne à proposer. C'est encore la guerre
et toutes ses religieuses sont occupées à l'hôpital.
A la rentrée, "l'asile" est fermé faute
de maîtresse et d'enfants. Il sera pourtant rouvert ultérieurement
puisque Marie Louise BEJANNIN née en 1921, aujourd'hui religieuse
en Égypte, se souvient de l'avoir fréquenté jusqu'à
l'âge de six ans. Elle a dû être la dernière.
Il est vrai que les BEJANNIN étaient les voisins immédiats
de cet "asile", qui était installé
dans les locaux actuels de la mairie.
Deux religieuses resteront à
Foncine le bas pour s'occuper surtout des malades. C'est après
1945 qu'elles seront remplacées dans cette fonction par des
religieuses appartenant à la congrégation des soeurs
missionnaires de N.D. des Apôtres venue s'installer aux Roqueries
vers 1936. Les fonciniers iront parfois se faire panser par Sœur
Colette revenue à Saint-Joseph, la maison mère.
La maison de repos des soeurs missionnaires,
aux Roqueries, sera fermée en 1980.
|