JOUEF

Jusqu'en
2004, il restait à Foncine le Bas, une usine.
L'usine
GIROD, qui a remplacé l'usine JOUEF. Le père DOUDIER
dans son livre "Foncine le Haut 1815-1980", expose
avec précision la création et la vie de cette entreprise,
jusqu'en 1980 évidemment.
A
son origine, en 1945, "Manufacture de tournerie et jouets
du Haut-Jura" crée par André Margerit, elle
devient, en 1953 "Jouet Français", puis en
1961 JOUEF qui deviendra en douze ans, le second constructeur de trains
miniatures et le premier exportateur français de jouets.
En
1965, JOUEF est à son apogée et compte 4 usines : Foncine
le Haut (90 personnes), Foncine le Bas et Sirod (chacune 40 personnes)
et Champagnole (60 personnes) à quoi il faut ajouter 250 à
300 personnes travaillant à domicile. Une dizaine au moins
de ces derniers étaient à Foncine le Bas. Jérôme
leur apportait chaque semaine leur provision de pièces à
assembler et reprenait en même temps le résultat de leur
travail.
A
Foncine le Bas, ma grand-mère Cécile, assemblait chez
elle des roues de wagons qu'elle fixait sur leur moyeu. Une machine était
installée chez chaque travailleur. La force motrice venait
de la jambe.
En 1982 un journal local publiait
un billet dont voici un extrait :
"Au cours de 1982, année
du redémarrage de l'entreprise, 25000 T.G.V modèle réduit,
ont été commercialisés en moins de dix mois.
Cette cadence est indiscutablement plus soutenue qu'à ALSTHOM.
L'échelle est différente; mais le travail n'en demande
pas moins de minutie et de patience. Les pièces moulées
viennent de Champagnole, à l'état brut. Il faut les
peindre, les décorer, mettre les moteurs (prérodés
en six minutes). Puis les carrosseries sont habillées. Travail
de Gulliver sur un train lilliputien ... Foncine le Haut est au Jura
ce qu'ALSTHOM est au territoire.
JOUEF a quitté Foncine pour
Champagnole avant de disparaître en 2001.
ALSTHOM
survit, mais après être passée d'ALS.THOM
à ALSTHOM en reniant ses origines, elle a perdu désormais
son H pour devenir ALSTOM car la langue du pays où
son siège a été transporté ignore cette
lettre.

 Grandeur et décadence
Grandeur et décadence C'est Georges HUARD, patron du Jouet
Français qui avait installé cette première antenne
jurassienne. Elle était placée sous la responsabilité
de Roger BUGNET et d'ailleurs, jusqu'en 1961, on travailla "chez
Bugnet" avant d'être employé Jouef. Champagnole,
l'usine A, va assurer l'injection, le montage, la fabrication des
aiguillages, des wagons, des rails. Mais la manne Jouef, avec notamment
le travail à domicile, va s'étendre sur toute la zone
montagneuse.
Foncine le Haut logea une importante
unité, fondée par M. Margerit. Des milliers de wagons,
de voitures à voyageurs, la tampographie à partir de
1965 y furent produits. C'était là aussi qu'on assurait
les modèles spéciaux, demandant un travail en finesse.
Il exista une annexe à Mouthe.
Foncine
le Bas assurait la production des moteurs, le bobinage et disposait
lui aussi, d'un atelier parallèle à Syam. Sirod était
spécialisé dans la production des locos diesel vertes,
puis des fameuses "Pacific", enfin des automobiles
de circuit. Salins montait les appareils de voie. Il y eut encore
Crotenay, Mignovillard, Sellières, affectés suivant
la demande à divers produits. On dit que deux mille personnes
oeuvrèrent simultanément pour Jouef en terre jurassienne.
Avant
même Champagnole, de 51 à 62, la marque avait sorti un
must. La Diabolic ou Pacific présidentielle est
un jouet simplifié inspiré par les machines carénées
d'avant-guerre. La superstructure de couleur noire est montée
sur un châssis de métal. Dans le Jura la production a
débuté avec les premières voitures à bogies
vertes et les Pullman. Le faible coût des plastiques injectés
permit rapidement d'élargir les propositions, wagons marchandise,
plats , tombereaux, citernes. En 55 Jouef sortait des trains électriques
prestigieux, images fidèles des fameuses BB 9003 et 9004 qui
venaient de battre les records mondiaux de vitesse. Ces nobles miniatures
étaient équipées d'un moteur curieusement appelé
"saucisson". En 55, apparaissait la loco tender 20
qui sera produite pendant 40 ans, à plus de deux millions d'exemplaires.
En 72, Jouef change de propriétaire et rejoint, dans le Jouet
Français Solido et Heller. Mais le groupe est mis en liquidation
en 80. Repris par Joustra (groupe CEJI), l'entreprise tente, face
à la concurrence des jouets électroniques, une activité
d'importateur. Surtout la qualité subit les effets négatifs
de cette déflation. Un nouveau dépôt de bilan
en 86, déjà accompagné d'un plan social, permet
une relance commerciale. On retrouve l'esprit original, quelques modèles
splendides sortent des chaînes. La marque s'associe à
de nombreux partenaires, Lilliput, Rivarossi, Lima. Mais le passif
reste inabsorbable. Un nouveau dépôt de bilan est présenté
fin 95. L'italien Rivarossi, l'un des partenaires de l'époque
précédente, devient propriétaire de Jouef. Mais
l'entreprise transalpine n'est pas sécurisée. Le premier
juin 2001, l'usine A ferme définitivement ses portes. La technologie
JOUEF quitte l'hexagone. Sa destination définitive, après
quelques tergiversations, semble bien opter pour la chine. Après
avoir été quelques temps associés à Lima,
c'est sous la marque anglaise Hornby qu'on retrouvera les trains Jouef.
 Foncine
"royaume du jouet ferroviaire" (en 1965)
Foncine
"royaume du jouet ferroviaire" (en 1965)
L'activité de JOUEF l'oblige
à des liaisons constantes avec la SNCF. C'est donc tout naturellement
que la "Vie du Rail", dans son numéro de décembre
1965, lui consacre quatre pages très illustrées. Laissant
de côté les paragraphes techniques, voici quelques lignes
intéressantes et photos tirées de ce numéro :
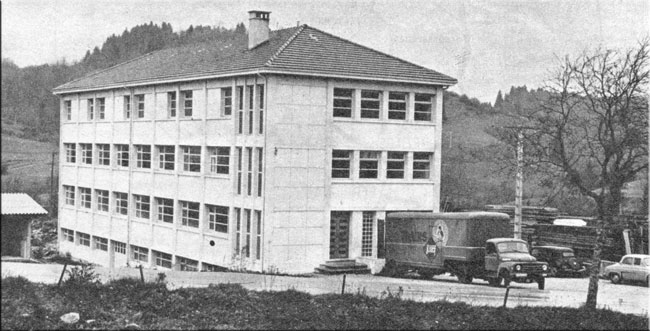
"L'appareil de production,
c'est essentiellement quatre usines dispersées sur vingt kilomètres,
quelques ateliers satellites, plusieurs centaines de travailleurs
à domicile, au total environ un millier de personnes dans une
région de ce Jura traditionnellement voué à la
petite industrie de précision, à l'horlogerie, à
la lunetterie, à la joaillerie, dans cette contrée aux
vastes forêts, où le jouet, autrefois en bois, possède
des attaches lointaines.
C'est donc à Foncine le
Haut, Foncine le Bas, à Sirod, que le "Jouet Français"
a fait construire en quelques années d'intervalles quatre usines
semblables dans leur aspect : blanches et simples, modestes dans le
décor grandiose des monts du Jura; semblables aussi dans leurs
structures : au premier niveau l'injection et la peinture, au second
niveau les ateliers de montage, au troisième et dernier, la
cartonnerie, les magasins de pièces détachées.
Ce qui frappe lorsqu'on pénètre dans une usine du Jouet
Français, c'est l'économie des moyens, la sobriété
de l'ensemble. "Un hall de marbre à l'entrée de
l'usine - m'avait dit fort justement le directeur - c'est une presse
à injection en moins, et cela c'est notre gagne-pain".
Donc pas de hall de marbre, pas d'interminables cousives de bureaux
directoriaux ou administratifs pléthoriques comme on en voit
parfois. Le directeur et son secrétariat - une personne ou
deux - et tout de suite, au-delà de la cloison vitrée,
la fabrication.
Chacune des usines a ses spécialités
: à Foncine le Haut, première usine du Jouet Français
en 1952, la fabrication des rails, celle des moteurs mécaniques,
le montage de la plupart des locomotives.
A Champagnole, les transformateurs,
les sous-stations, les contacteurs, les appareils de voie à
équipements électriques.
A Foncine le Bas, la fabrication
des moteurs de locomotives.
A Sirod, la fabrication des automobiles
des circuits routiers et des locotracteurs, moteurs y compris. Voilà
en gros pour la répartition théorique des tâches,
mais en fait, chaque usine est conçue de telle sorte qu'elle
peut venir en aide immédiatement à chacune des trois
autres pour une fabrication qui n'est pas normalement de son ressort.
Pourquoi quatre usines et non
une seule où la fabrication aurait peut-être pu être
organisée plus rationnellement ?
C'est une question de main
d'oeuvre; les jurassiens sont fidèles à leur mode de
vie, au bourg ou au village natal. Les usines de JOUEF sont ainsi
le signe de l'entreprise aux dimensions raisonnables ne portant pas
atteinte aux structures rurales, apportant localement une certaine
prospérité matérielle sans les inconvénients
et les bouleversements créés par les implantation démesurées.
Un des aspects les plus curieux
des fabrications de JOUEF est la part prise par les travailleurs à
domicile. Il est vrai qu'il s'agit d'une activité d'appoint
traditionnelle dans le Jura. Pour beaucoup aujourd'hui, il ne s'agit
plus d'un appoint mais de la source essentielle des revenus. Comme
le gain est du même ordre qu'en atelier, nombreux sont ceux
qui préfèrent rester chez eux, aménageant leur
horaire en fonction des occupations rurales, pastorales ou simplement
ménagères.
On voit des cartons JOUEF empilés
sous le porche des fermes isolées, mais il y a aussi des villages
entiers où, derrière chaque fenêtre, on colle,
on décore, on assemble voitures ou wagons, on empile des tôles
de transformateurs ou bien l'on bobine des enroulements;
il y a ainsi,
par exemple, le village des rails, le villages des routes, chacun
constituant un groupe homogène à l'intérieur
duquel on se passe, de maison en maison, les pièces en cours
de montage. Le paradoxe che JOUEF, c'est que, en fabriquant des trains
au 1/87, ces jurassiens qui, pour la plupart, ne connaissent du chemin
de fer que leur ligne de Morez à Andelot, se font ainsi une
idée de ce qu'est le matériel moderne de la SNCF. Quelques
jeunes femmes, tout en peignant le sigle prestigieux en lettres d'or
sur le bandeau rouge des voitures, rêvent d'un voyage dans un
train de luxe.
Il y a encore quelqu'un pour
qui les liens entre le Jouet Français et la SNCF sont en ce
mois de décembre particulièrement évidents :
c'est le chef de gare de Champagnole. Comme le reste de l'année,
il lui faut sortir de l'embranchement JOUEF le wagon complet, quasi
quotidien renfermant deux ou trois mille envois de détail;
mais en plus, il se demande chaque jour comment faire partir à
temps les centaines de colis express qui s'ammoncellent dans sa gare
et jusque dans la salle d'attente des voyageurs. Ces envois de dernière
heure, qui répondent aux appels de détresse des détaillants
sont un peu son cauchemar. Les vraix trains ont la réputation
d'arriver à l'heure. Il faut bien aussi, que les petits trains
de Jouef parviennent à l'heure pendant la nuit de Noël,
à leurs heureux destinataires."

 Les
Lunetteries
Les
Lunetteries
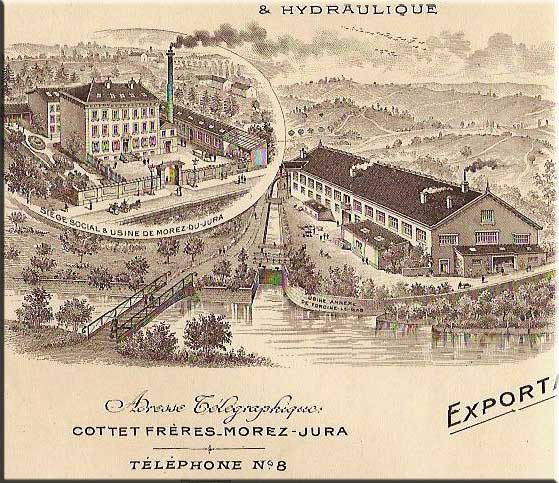

Foncine le Bas comptait deux lunetteries.
Celle "du haut" était
à l'origine une fabrique d'instruments de mesures tels que
baromètres, thermomètres ou aréomètres
crée en 1888 par Antoine BESSON et Simon GUICHARD.
Vers
1900 Jules COTTET, reprend cette usine. Il avait fondé vers
1895 à Gouland une "fabrique d'horlogerie et de lunetterie"
, devenue ensuite société "COTTET frères"
et transférée à Morez. Dans "La petite
fille des rivières" on voit la photo d'une publicité
vieille de 100 ans concernant "Jules COTTET et Jules POUX manufacture
de lunetteries, 90 rue de la République à Morez".
A Foncine, Cottet produit des montures de lunettes et des pince-nez.
En 1913 la société des
lunetiers achète cette usine.
Celle "du bas", a été
construite plus tard par Jules COTTET, qui s'était séparé
de ses frères. En 1914 la Société des lunetiers,
"La SOCE" rachète les deux usines. Elle les
fusionne en 1930 puis, en 1931, elle les ferme et en transfère
la fabrication à Morez.
L'usine du haut a compté jusqu'à
80 ouvriers. Des familles entières y travaillaient telle la
grosse famille BLONDEAU qui occupait une bonne partie de l'ancienne
caserne des douanes. Celle du bas, plus moderne n'était pas
moins importante.
Dans l' "histoire d'ESSILOR"
de François FARAUT, on lit à propos de ces usines :
En 1913, l'usine de Morez de la Société
des lunetiers, est la seule digne de ce nom dans cette ville. Le
travail y est régulier et constant. Le chômage rare ...
Certains industriels novateurs ont même dû s'installer
à quelque distance de Morez pour pouvoir utiliser du matériel
moderne à l'abri des manoeuvres de leurs concurrents qui débauchent
leurs ouvriers.
L'usine de Foncine le Bas est-elle
de celles-là ?
Peu de temps après sa construction
et à peine en pleine exploitation, elle est achetée
en 1914 à Jules COTTET qui devient sociétaire comme
bien d'autres avant lui, qui avaient apporté leurs entreprises
à la Société des lunetiers ... Une partie des
ouvriers sont en même temps cultivateurs et les effectifs sont
un peu réduits en juillet et en août. Les lunettes sont
entièrement finies à l'usine, le montage à l'extérieur
et le rhabillage à Morez.
Dans le rapport de la gérance
à l'Assemblée Générale de la Société
des lunetiers des 4 et 5 juillet 1914, on lit :
"L'achat récent de
notre usine de Foncine est venu à point pour faciliter l'extension
de nos affaires dans ... les Indes et la Russie".

La lunetterie du haut est devenue
une colonie de vacances ("loisirs 2000") et celle du bas,
après avoir été utilisée comme salle de
théatre par "Gai mon village" a servi de magasin
d'antiquités et abrite maintenant une sérigraphie.



