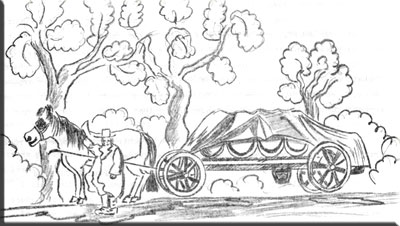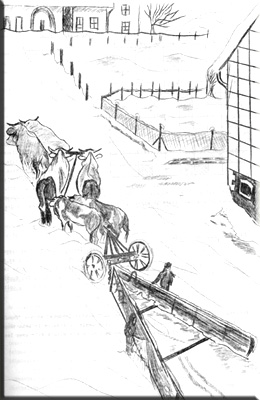|
Une industrie des Foncines : le Roulage |
Les rouliers n'étaient pas tous du Grandvaux. Ceux de Foncine ne sont pas entrés dans la légende comme leurs voisins, et pourtant ils jouaient un rôle important dans la vie économique de la région. Ce texte, de Madame A. Monnier, tiré du "Gaulois" de juin 1974, (petit journal édité par les "Amis de la Chaux des Crotenay" et qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui) nous renseigne sur ces voituriers de Foncine, et sur leurs relations particulières qu'ils entretenaient avec leurs clients genevois. |

Aucun auteur franc-comtois, lorsqu'il évoque le paysan de la région : le montagnon, n'oublie de mentionner le granvallier et ses habitudes. mais peu du foncinier qui, à l'instar de ses voisins, ne manque pas d'augmenter ses ressources en pratiquant le roulage. Le roulage fut certainement pour beaucoup dans l'aisance ancienne du foncinier et sa disparition, au début du XXème siècle, fut sans doute une des causes primordiales de la décadence des Foncines. Les rouliers de Foncine n'existent plus mais nous pouvons facilement reconstituer leur vie à travers les textes qui leur sont consacrés. Dévalant les rudes pentes de Malvaux, avant la construction de Mouthe à Syam au XVIIIème siècle, leur grandvallières allaient par cinq ou six, chacune tirée par un cheval à forte encolure. Une réclamation adressée en 1790 par les habitants de Saint-Laurent à la municipalité de Dijon nous renseigne sur les conditions de transport des marchandises de la montagne. Au lieu d'une guimbarde tirée par huit chevaux en plaine, il fallait huit grandvallières tirées par un seul cheval chacune pour descendre la même quantité de marchandises. Le droit de roulage imposé par voiture et par attelage était donc particulièrement défavorable au commerce des plateaux du haut Jura. De Foncine, les voituriers gagnaient leur première étape : Champagnole, ville située au débouché des défilés, à proximité du vignoble, centre d'auberges et de maisons de transport. Dans ses voitures, le roulier entassait tous les produits locaux, le miel de la montagne, les "Foncine", les nombreux fromages qu'on expédiait jusque dans les ports pour la cargaison des navires, les nombreux articles de boissellerie.
N'oublions pas que depuis la charte de 1372, l'habitant des Foncines a le droit d'essarter du Val de Sirod à la Roche du Risol, d'utiliser le bois pour son habitation, son usage personnel et en faire des objets. De Champagnole, le roulier gagnait les villes du Revermont, là où les vignerons lui donnaient volontiers une barrique de vin en échange de ses échalas, de ses fûts, de ses ustensiles de bois nécessaires aux vendanges. Notre roulier remontait ainsi à bon compte sa provision de vin ainsi que les lourdes charges de sel destinées aux chalets de montagne pour la fabrication des fromages. S'il s'éloignait davantage, il pouvait acquérir des produits d'épicerie : sucre, café, chocolat, qu'il remontait aux Foncines à une époque où les commerçants ambulants n'existaient pas encore. Une fois ses marchandises écoulées, le foncinier trouvait du fret et se déplaçait à travers toute la France. Ni pluie, ni vent ne l'arrêtait et en ce cas, il s'abritait sous l'auvent de sa voiture où il s'endormait, se fiant au pas sûr de son cheval. Le soir, il faisait halte dans quelque auberge. Le foncinier était à la fois commerçant, colporteur, négociant. Cette pratique est très ancienne. A t'elle débutée dans le Grandvaux, sur le passage des voituriers septmoncellans ? On peut le supposer. Cependant, on n'a pas vu se développer des habitudes analogues autour de la passe de Jougne, très fréquentée au Moyen Âge.
N'oublions pas que le texte de 1372 accordait également aux fonciniers le droit de charroyer là où ils l'entendaient, les nombreux ustensiles de leur fabrication. Cousin nous signale vers 1550, dans la communauté des Foncines, 27 roues pour meules et scies pour y fabriquer des vases en bois, propres aux usages domestiques. En 1789, il y avait neuf marchands, sept voituriers, un muletier qui devaient vendre au loin les produits de l'industrie des Foncines (1). Le voisinage de la Suisse a contribué puissamment à la fortune des habitants en favorisant le commerce interlope. Mais il existe un texte assez ancien qui nous renseigne sur les habitudes des fonciniers; habitudes qui faillirent leur attirer de graves ennuis. En 1574, au moment où l'inquisition sévissait en Franche-Comté, le lieutenant général de la gruerie fait remontrance à la Cour des habitudes des fonciniers et des conséquences néfastes qu'elles engendrent. En conséquence, il demande l'interdiction et la défense du commerce et de l'exportation des bois du Comté de Bourgogne (2). Bien que le motif principal en soit l'introduction dans les hautes montagnes des "mauvaises doctrines et institutions hérétiques", le texte n'en apporte pas moins de nombreux renseignements sur les habitants du Val de Saine à cette époque. Nous apprenons ainsi que le foncinier, villageois plein de simplicité connaissait mal la religion catholique romaine.
En effet, dépendant de Sirod, le vicaire devait éprouver des difficultés, surtout en hiver, pour aller catéchiser ses ouailles de Foncine. En vue d'effectuer leur négoce, les fonciniers passaient dans le pays de Vaud, attirés par les foires de Genève, y vendant leurs ouvrages de sapin et fustailles. Or, la fréquentation des foires de Genève entraînait des conséquences assez graves. Les fonciniers s'y trouvaient en contact avec les hérétiques du pays de Vaud. A leur contact, ils se trouvaient exposés à de multiples dangers dont l'un était la tentation des viandes qu'on leur offrait les jours défendus. Pour les genevois, attirer dans leur orbite les habitants des Hautes-Joux devait être tentant et valait bien le prix des viandes sacrifiées. Il était donc urgent de mettre fin à ce trafic. Par trois fois, Froissard de Broissia insiste sur la naïveté et la simplicité des gens des Foncines. Cependant, les "pauvres idiots" savent fort bien vendre leurs produits. A cette époque où il n'existait pas d'objets de faïence mais seulement quelque vaisselle d'étain, les ustensiles de bois étaient d'une nécessité absolue et les fonciniers, s'ils ne trouvaient pas à vendre leur marchandise à leur convenance sur les marchés comtois, gagnaient le pays de Vaud où ils trouvaient facilement acquéreurs. De ces pratiques, il résultait que les objets de bois étaient coûteux. Le foncinier avait donc pris l'habitude des chemins du pays de Vaud. Parcimonieux de son argent, ses frais de route étaient minimes, malgré la distance plus grande. Dépensant très peu pour ses vivres et son couchage, son intérêt était de chercher une clientèle plus généreuse. Mais aimant malgré tout la bonne chair, il profite sans vergogne et sans bourse déliée des viandes que lui proposent les gens de Genève.
Pour finir, on peut se demander si les fonciniers ne se sont pas faits prêtres. Nous les voyons, de 1650 à 1790, lutter pour l'érection d'une paroisse contre le prieur de Sirod. Il valait bien mieux passer pour des idiots que de connaître les geôles de l'inquisition. Et puis le montagnon renâcle à payer des dîmes à un prieuré lointain, alors qu'il voudrait un prêtre à demeure, comme le montrent les nombreux procès intentés par le prieuré aux communautés qui en dépendent. Si la pratique du roulage a enrichi les fonciniers, elle a également développé leur esprit d'initiative, leur curiosité, leur envie de tout comprendre et de tout envisager. Ils possédaient une culture au-dessus de la moyenne, et on peut constater la transmission de ces qualités par atavisme chez leurs descendants (3). 1) Suzanne Daveau : "Une communauté jurassienne, les Foncines" (revue de géographie de Lyon 1954) 2) B. 180 Doubs A.D. Cité par Febvre : "l'inquisition en Franche-Comté" 3) Cornillot : "La Franche-Comté" |