Voir également :
En
1930 Foncine le Bas comptait 3 scieries situées chacune sur une
cascade, à chacune des extrémités du village.
Bien
entendu ces usines généraient des emplois nombreux hors
d'elles mêmes (bûcherons, voituriers, cafés et commerces
divers).

 L'usine
du haut L'usine
du haut
a été créée
en 1888 à la place d'un moulin déjà signalé
sur le plan cadastral de 1826, et qui en 1855 comportait 3 paires de
meules, une scie et un battoir.
Propriété d'Henri BERROD,
qui produit, entre autres, des mâts de bateaux pour la Marine,
elle est détruite par un incendie vers 1914, puis reconstruite
sur trois étages, les turbines se trouvant en bas de la cascade
et les châssis au niveau de la route. Un bâtiment servant
de bureau et de logement est bâti sur le chemin qui conduisait
auparavant à la roue à aubes.
Vers 1920 on y installe deux turbines
qui fournissent l'électricité à l'usine elle-même
ainsi qu'au village.

Cette usine est passée, par le
jeux des mariages et héritages, des BERROD aux VUILLET. Ces derniers,
après avoir construit le "château", ont fait
faillite et l'usine a été reprise par le Consortium Général
d'Optique et d'Industrie, puis par les chantiers et ateliers de Bourgogne
avant d'être fermée en 1948. Seule la chute d'eau est encore
utilisée aujourd'hui pour produire de l'électricité
revendue à EDF.
De 1932 à 1948, le contremaître
de cette usine était André GUY, qui jusqu'en 1936 logeait
dans le bâtiment annexe à l'usine. Outre son travail quotidien
qui s'exerçait autant à l'usine elle-même que sur
les chantiers forestiers. André GUY devait surveiller la centrale
et les lignes électriques du village.
La centrale, située au niveau
inférieur de la rivière, était accessible par une
suite d'échelles en bois, fréquentées par les araignées,
guêpes et divers locataires. Deux fois par jours il fallait les
emprunter pour aller graisser les machines. Souvent il fallait remplacer
les grandes courroies qui s'échappaient des poulies, en utilisant
pour cela une longue perche terminée par une fourche. Et puis
matin et soir, il fallait descendre pour ajuster la quantité
d'électricité fournie par la turbine aux besoins de la
population (ajuster les "bougies" produites aux "bougies"
nécessaires, unité de mesure de l'époque).

A l'automne, une autre tâche s'imposait.
Les feuilles mortes s'accumulaient contre la grille située à
l'entrée du canal d'arrivée d'eau. Plusieurs fois par
jour, il fallait dégager la grille à l'aide d'un râteau
à long manche.
Enfin, car les disjoncteurs n'avaient
pas encore été inventés, les "plombs sautaient"
souvent. Un abonné trop gourmand ou un orage en était
souvent la cause. Chaque quartier du village avait sa dérivation,
et à l'origine de chaque dérivation on avait placé
un fusible en haut d'un poteau. Lorsque ce fusible fondait, on venait
chercher André GUY qui partait avec ses outils, chaussait ses
griffes et grimpait au poteau pour réparer. Cela arrivait fréquemment
sous les orages d'été.
 La scierie du bas La scierie du bas
bénéficiait d'une chute
moins haute certes, mais plus importante car la Saine avait reçu,
en traversant le village, les eaux de la Sainette et du Galaveau.
Elle avait été créée
en 1830, (probablement à la place d'un martinet ou moulin car
toutes les cascades étaient utilisée depuis longtemps)
par les JOBEZ / MONNIER, peut-être par Hugues MONNIER "riche
d'un million" fils de Claude Etienne MONNIER qui fut maire de Syam
et président du Conseil Général, et de Marie Adélaïde
JOBEZ (la "dame en rouge" du château de Syam).
Les
JOBEZ possédaient une partie du Mont Noir. Les MONNIER originaires
des Planches en Montagne, possédaient les forges de Syam, Baudin
et Rochejean entre autres. Ils étaient alliés aux DE LAITTRE
et aux LE MIRE de Pont de poitte. En
1900 cette usine appartenait à Pierre THOUVEREY qui possédait
aussi les usines du Saut et du Metan, à Fort du Plasne. Elle
passa ensuite à son fils Ferdinand.
Lorsque
le train et le tacot arrivèrent à Foncine, un embranchement
particulier fut créé pour permettre de charger le bois
sur les wagons, au chantier lui-même. C'est un train transportant
vers Foncine le haut, un chargement en provenance de cette usine qui
fut l'objet d'un accident resté célèbre. Ch. THEVENIN
(Progrès du 1.10.95) rapporte le récit que lui en fait
Régine CHARNAUX, fille de Ferdinand THOUVEREY :
"Le
chauffeur stoppa sous le château d'eau, entre Foncine et la Chevry,
pour parfaire ses "pleins". Il sauta de la machine mais oublia
de serrer sa "mécanique". L'attelage sans pilote commença
à dévaler la pente et acquit rapidement une vitesse inadaptée
aux possibilités des voies. Le convoi fou, entraîné
par la force centrifuge dans la courbe des Douanets, se coucha sur le
coté".
En
décembre 2012, Claude Charnaux-Guillaume m'envoie quelques photos
de la scierie et de Foncine le Bas. Vous pouvez les voir en cliquant
sur la photo ci-dessous.
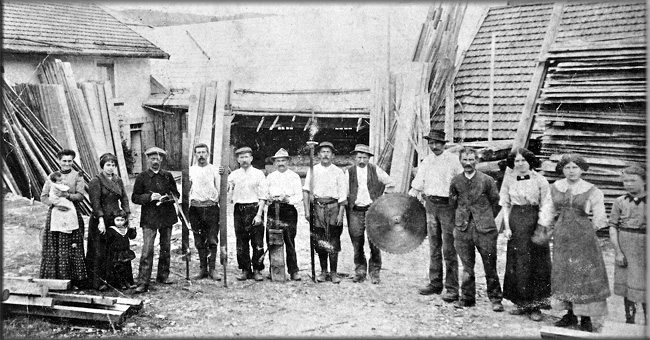
Ces deux scieries devaient être
abandonnées en 1950. André GUY, contremaître de
celle du haut et Jean ROUSSET gérant de celle du bas, décidèrent
de s'associer pour en maintenir une en activité. Ils créèrent
la société GUY-ROUSSET et rachetèrent celle du
bas. Vers 1960, ils la cédèrent à Jean PATOZ.
Elle brûla dans la nuit du 31
décembre 1968 au 1er janvier 1969. Ses restes enfumés
furent le dernier spectacle de Foncine qu'emporta André GUY lorsqu'il
fut conduit le 2 janvier 1969 à l'hôpital de Champagnole
où il devait mourir le 26 juillet.
Dans les années 1945-1950 cette
usine fabriqua en grande quantité des meubles de ménage
: table et armoires, destinées aux populations sinistrées
par la guerre. Ces meubles étaient livrés sans être
peints. L'usine était appelée de ce fait, "le
bois blanc".
A ces deux scieries, il faut ajouter
celle de
 La
Gypserie La
Gypserie
Comme son nom l'indique, c'était
à l'origine un moulin destiné à transformer le
gypse extrait d'une mine dont on peut encore voir l'entrée.
En 1850, selon Rousset, elle appartenait
à Claude Joseph BOURGEOIS. Son exploitation, interrompue pendant
la guerre 1914-1918, reprit mais sans succès, en 1919. Les mines
abandonnées avaient été inondées.
Félicien BOURGEOIS la transforma
en scierie. Le 25 mars 1928, il la loua en même temps que l'immeuble
a usage d'habitation et de culture, à Joseph GUY, un chapelan
venu de Chapelle des Bois à Rapoutier Dessus en passant par Morez
où il était horloger. Le bail portait, outre les bâtiments
et les terres, sur un "immeuble contigu servant à l'exploitation
d'une petite scierie composée d'un châssis multiple à
chariot et d'une scie circulaire". L'exploitation de la scierie
fut alors suspendue car des réparations étaient nécessaires
et ne pouvaient se faire avant la fin de l'année.
Joseph GUY mourra le 30 octobre 1932.
Cette scierie sera utilisée en 1943-44 comme dépôt
de munitions par le maquis.
Ces munitions ont été
distribuées le 27 août 1944, date à laquelle les
F.F.I./F.T.P ont donné l'ordre de tendre des embuscades aux allemands
en retraite. Trois barrages furent donc organisés à Foncine
le Bas : en haut de Malvaux, aux Monets et au dessus de la Gypserie.
En fait, ces barrages n'auront jamais à intervenir, les allemands
ayant attaqué celui du Rocheret, le 30 août.
Ce 30 août, un ancien foncinier
fait les 100 pas entre la place et la maison Berrod.
Il fait partie d'une compagnie du groupe
Vauthier, de Fontenu, en réserve au centre du village. Avec lui,
le lieutenant DANEAU, commandant la compagnie de gendarmerie de Lons,
qui avait rejoint le groupe quelques jours plus tôt.
Vers 2 heures du matin, le premier proposa
de se rendre chez Marguerite Blondeau qui leur offrirait peut-être,
un bol de café chaud. Il cogna longtemps à la porte de
la ferme, avant que la "tante Guite", un peu pâle, finisse
par ouvrir après l'avoir reconnu. Le café fût chauffé,
servi et les visiteurs priés de faire vite. A l'époque,
Foncine était pratiquement vidé de ses habitants, tous
partis dans les bois alentours, comme aux Serrettes par exemple.
Si l'on en croit François MARCOT
et le Progrès, c'est à Foncine le Bas qu'on a relevé
l'un des premiers actes de Résistance. L'un et l'autre donnent
en effet la même relation :
"Le 21 août 1941 le câble
téléphonique militaire allemand est saboté à
Foncine le Bas". On en sait pas plus.
Il y a une dizaine d'années,
un ancien attribuait en réalité ce fait d'armes, à
un gamin farceur, le Dédé !
 L'atelier de Maxime FUMEY L'atelier de Maxime FUMEY
Ce n'était pas une scierie, mais
on y travaillait aussi le bois. Cet atelier était situé
le long du chemin conduisant de l'école à l'église;
ses machines étaient actionnées par l'eau du Galaveau,
ce ruisseau qui emmène à Malvaux une partie des eaux du
Grandvaux. Jusqu'en 1940, Maxime FUMEY, ébéniste, y fabriquait
des cabinets de pendules ou des supports en bois pour thermomètres
ou baromètres.

Avant les Fumey, cet atelier a appartenu
à Severe PAGNIER, "un marchand de bois d'usage" et
"fabricant de pignon" qui l'avait bâti, ou agrandi un
peu avant 1865. On sait en effet qu'en décembre 1865, Aubin POUX,
qui possédait une petite usine près du pont central avait
demandé à reporter sa prise d'eau "plus en amont,
le long du bâtiment neuf de l'usine Pagnier". Il avait été
autorisé à construire un "canal large de 0,66 mètre,
parallèle au mur de l'usine PAGNIER, puis contournant le rocher
saillant sur lequel est appuyé l'angle aval de cette usine".
Cette partie aval a été détruite lors d'un incendie.
La famille PAGNIER venait à la
Norbière où elle avait acquis quelques dizaine d'hectares
de sapins. A la recherche d'une force motrice qu'elle ne trouvait pas
à Chapelle des bois, elle était descendue d'abord à
la Chevry, puis vers 1850 à Foncine le Bas. Elle était
alliée aux GUY et aux MACLE, entre autres.
C'est elle qui avait donné à
la paroisse le terrain où a été construit le nouveau
cimetière dont elle s'était réservée une
partie. Aujourd'hui, seule une croix rouillée rappelle son nom.
Une cloche de l'église a eu pour marraine une fille de Severe,
Anna. Son nom est inscrit sur cette cloche, comme on a peu le voir lors
de la réfection du clocher en 2000.
Vers 1900, Paul PAGNIER, un fils de
Severe, partit avec sa famille exploiter une scierie importante sur
la Lemme, à Morillon. Cette famille se dispersa vers 1930. Une
fille, Marie, née à Foncine le Bas, épousa César
VIONNET, de la grange du Cernois toute voisine.
Il est certain que bien avant ces scieries,
les cascades étaient utilisées pour faire tourner des
moulins, "serres" (scieries), "rebattes"
(battoirs) ou martinets. Beaucoup de moulins étaient "à
trois tournants" (moulin à grain, serre et rebatte). La
rebatte servait à écraser le chanvre ou les écorces
d'épicéas dont on tirait le "tan".
On trouvait aussi les "foules"
ou "foulons", grosses pierres utilisées pour fouler
les étoffes.
Quand aux martinets et clouteries, ils
transformaient les barres, plaques ou tôles de fer venues des
forges, en clous, fil, etc .... Ils exigeaient du feu et un soufflet
pour "pousser" le feu.

 La diamanterie La diamanterie
Il y eut à Foncine le bas, une
diamanterie dont la carrière semble avoir été éphémère.
En 1890, Emile Dalloz, diamantaire à Saint Claude, avait ouvert
un atelier au Moulin Choudet, à Foncine le Haut. Son entreprise
employa jusqu'à 40 ouvriers et ouvrières, puis passa à
la coopérative "Le Diamant" qui compta près
de 120 personnes.
La guerre de 1914-18 puis la grande
crise de 1929, amenèrent sa fin. Elle ferma en 1932. La petite
usine de Foncine le bas semble avoir été créée
par "le Diamant" à la belle époque. Il
ne reste que son nom, du moins pour les anciens. Elle est devenue par
la suite une fabrique de boites à fromages puis une boissellerie.
Monique MICHOUDET a bien voulu communiquer
un extrait de l'Almanach du commerce de 1879, que voici :
| 47
Km de Poligny, 467 habitants, 4 fromageries |
| Poste
et télégraphe : |
Foncine
le haut |
| Bois
en gros : |
MARTIN,
PAGNIER S. |
| Cafetier
: |
JACQUET |
| Epicerie
et mercerie : |
BRAZIER,
DAYT Théophile, POUX Albin |
| Farines
et graines : |
DAYT
Théophile, JEANNIN Cyrille |
| Fil
de fer et clouterie : |
POUX |
| Forge
: |
LIBOZ
J.F |
| Fromage
: |
JEANNIN
Cyrille |
| Gypse
et plâtre : |
BOURGEOIS
père et fils |
| Moulin
et scierie : |
MARTIN,
PAGNIER S. |
| Tanneurs
: |
MUNIER
frères |

|
 :
:  :
: